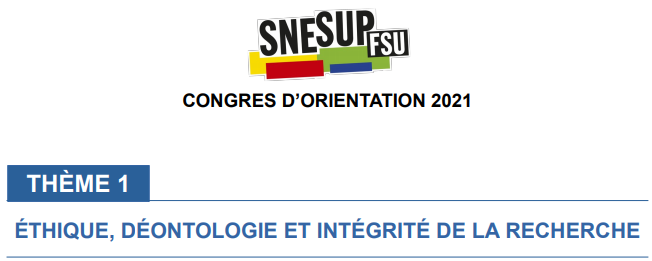Les pressions de toutes sortes et en particulier des gouvernements successifs modifient profondément les conditions d’exercice du métier d’enseignant·e-chercheur·e et de chercheur·e et sont responsables des dérives. Elles sont des obstacles à l’exercice de nos missions d’enseignement et de recherche compatibles avec ce qui constitue notre éthique professionnelle. À l’heure où beaucoup d’institutions tentent de se doter de textes encadrant les activités de recherche, le SNESUP-FSU doit, en lien avec les autres syndicats de l’enseignement supérieur de la FSU, faire valoir ses propositions sur ces sujets. Ces pressions s'exercent tout particulièrement sur les personnels précaires les plus fragiles. La mise en concurrence est également préjudiciable à l'égalité femme-homme. Les enseignant·es-chercheur·es et chercheur·es, titulaires et non titulaires, subissent les conséquences de choix politiques destructeurs qui peuvent induire des manquements :
-
la course aux financements par appels à projet (AAP européens, nationaux et régionaux) et aux publications,
-
la concurrence exacerbée instituée en mode de fonctionnement,
-
l'évaluation quantitative des individus, des équipes et des structures de recherche,
-
les politiques de site définissant les périmètres dits d’excellence et incitant les institutions à la spécialisation excluent des pans entiers de la recherche,
-
le recul de la démocratie universitaire et des instances démocratiquement élues via des comités ad hoc dans le cadre des IDEX, ISITE, et aux AAP des PIA.
Il convient de s'opposer à l’emballement du système en donnant aux chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es les moyens et le temps de préserver une démarche scientifique dans des projets de longue haleine. La recherche demande un temps long avec lequel l'emploi de contractuel·les est en contradiction comme l’est la concurrence généralisée.
Actuellement on constate que les AAP constituent, au bout du compte, des instruments de casse du service public de l’ESR sans que leur pertinence scientifique soit établie. Le financement récurrent doit être augmenté à hauteur des besoins, il doit constituer la règle et les financements par AAP l’exception. La redistribution de ces ressources se doit d'être équitable entre établissements et au sein des établissements.
Par ailleurs l’aide à la recherche privée ne doit pas, dans le contexte de contrainte budgétaire, se faire au détriment de la recherche publique. Concernant le Crédit Impôt Recherche (CIR), la dépense fiscale occasionnée n’a aucune justification à partir du moment où il n'a jamais favorisé une augmentation de la dépense privée de R&D ni permis de développer l'emploi scientifique de jeunes docteur·es en France. Cet argent public doit être utilisé en priorité pour accroître le financement récurrent des laboratoires et des équipes de recherche des établissements et des universités.
Il convient à la fois d’être vigilant quant à toute tentative de limiter de manière abusive la liberté des chercheur·es et des équipes de recherche tout en demeurant exigeant quant aux normes collectives qui doivent encadrer nos travaux. C’est à ce prix que nous conserverons la confiance des étudiant·es, de nos concitoyen·nes et que nous pourrons œuvrer pour le bien commun.
La réflexion sur l'éthique, la déontologie et l'intégrité scientifique est inhérente à la recherche, en conséquence il convient de :
-
S'opposer aux processus induisant une concurrence généralisée entre collègues, équipes et universités et promouvoir un modèle coopératif ;
-
Réaffirmer que les AAP doivent être l'exception et le financement récurrent la règle ;
-
Veiller au strict respect des libertés académiques et promouvoir une production et une diffusion de connaissances universelles, libres et indépendantes de tous les pouvoirs ;
-
Se mobiliser en faveur d'un plan de résorption de la précarité par la création massive de postes statutaires et pour l'amélioration des conditions matérielles et professionnelles des personnels précaires ;
-
Réaffirmer l'importance de l'évaluation qualitative par les pairs de la discipline et le refus des indicateurs quantitatifs des critères d'évaluation des chercheur·es et enseignant·es-chercheur·es, des projets et des structures de recherche ;
-
Réaffirmer les rôles incontournables du CNU et du CoNRS et exiger le rétablissement de toutes leurs prérogatives notamment leurs pouvoirs décisionnaires ;
-
S'opposer à la mise en place des dispositifs de la LPR dans les établissements notamment CDI de mission, tenure tracks et recrutements hors CNU ;
-
Faire revenir les ressources financières publiques qui ont été transposées au profit de la recherche privée via notamment le CIR pour accroître le financement récurrent des laboratoires et des équipes de recherche des établissements et des universités et atteindre au minimum 1 % du PIB nécessaire au maintien du niveau international de la recherche française ;
-
Œuvrer pour des comités d'éthique et de déontologie réellement indépendants de la gouvernance des établissements et de l’HCERES, désignés de façon collégiale par les pairs. Leur assurer les moyens de fonctionner. Ces comités conseillent, aident et émettent des avis ;
-
Préserver le désintéressement de l'activité de recherche en refusant les dispositifs d'intéressement financier des chercheur·es et en revalorisant les salaires ;
-
Les établissements ont pour responsabilité de mettre en place un environnement et une qualité de travail favorisant un enseignement et une recherche intègres avec et pour l’ensemble de la communauté universitaire, avec une politique promouvant une démarche déontologique juste ;
-
Augmenter le nombre et le montant de tous les financements permettant à tous les doctorant·es la réalisation de thèses dans de bonnes conditions et dans toutes les disciplines.